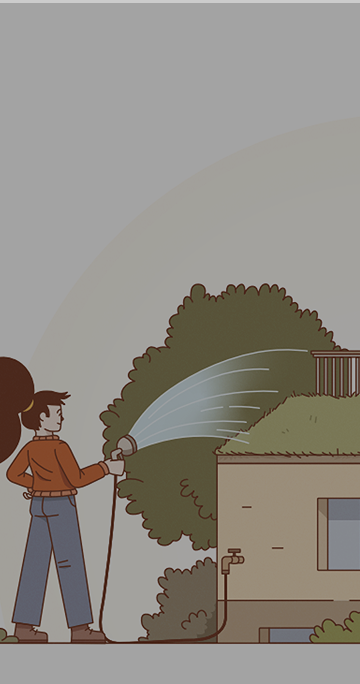Questions à Mario Paolone
Comment les réseaux électriques doivent-ils anticiper 40 GW de puissance solaire installée à l’horizon 2050 ?
Une telle puissance va fortement impacter les réseaux de distribution. Dans le contexte d’un programme de recherche, nous avons montré qu’un risque de congestion dans les réseaux de distribution de moyenne tension apparaît à partir de 13-14 GW de puissance installée. Il est donc nécessaire de compléter le renforcement classique de ces réseaux avec une planification optimale intégrant des systèmes de stockage d’énergie distribuée (par exemple, sous forme de batteries). Cette combinaison permet d’obtenir des solutions nettement meilleures sur les plans économique et technique.
« Il faut intégrer correctement les batteries afin qu’elles soient pleinement utiles au réseau. »
Quels types de stockage doit-on envisager ?
Les solutions à adopter dépendent de la topologie du réseau, de l’espace disponible et surtout de l’échelle temporelle visée, c’est-à-dire de la durée pendant laquelle l’énergie doit être stockée. Pour un stockage de quelques heures, les batteries basées sur le lithium sont les plus adaptées. Pour des périodes plus longues, sur plusieurs jours ou même plusieurs mois, il faut se tourner vers des systèmes de power-to-gas.
Ce processus convertit l’électricité solaire excédentaire en hydrogène, puis en méthane de synthèse, un gaz facilement stockable et réutilisable. Pour alimenter durablement cette production, des systèmes de captage du CO₂ devraient être mis en place afin de fournir le CO₂ nécessaire à la synthèse du gaz. Le pompage-turbinage est aussi une option excellente que l’on prévoit d’exploiter largement à différentes échelles temporelles. Mais son potentiel est quasiment atteint en Suisse ; il ne reste que quelques possibilités pour surélever certains barrages et augmenter leur capacité.
Les batteries au lithium sont souvent critiquées. Quelle sera la place de cette technologie dans les années à venir ?
C’est une technologie mûre, fiable et de plus en plus intéressante financièrement – on estime les coûts actuels autour de 100 dollars par kilowattheure stocké (avec une prévision à la baisse). Un autre atout est le potentiel de seconde vie des batteries lithium. Une fois reconditionnées, les batteries des voitures électriques peuvent en effet servir plusieurs années de façon stationnaire. Mais pour qu’elles soient pleinement utiles au réseau, encore faut-il intégrer correctement ces unités de stockage.
De nombreux particuliers vont peu à peu s’équiper de batteries domestiques. Et en ce qui concerne le réseau lui-même, il faut savoir que les GRD ne peuvent pas posséder leurs propres batteries, pour des raisons réglementaires. Ce sont donc des acteurs tiers qui les exploiteront et fourniront ce service au réseau. L’enjeu pour les GRD sera de structurer de véritables marchés locaux afin de valoriser pleinement l’ensemble de ces ressources, comme le prévoit notamment la loi sur l’électricité dans le contexte des communautés énergétiques.
Où faudra-t-il installer ces batteries ?
Il n’y a pas de réponse simple et unique ; une modélisation fine pourra guider les choix optimaux en pratique. Nous travaillons actuellement sur un projet de recherche afin de tester une planification intégrant tous les niveaux de tension, du transport jusqu’à la distribution. Ce projet doit notamment nous permettre de déterminer à quel niveau placer ces dispositifs de stockage, et en quelle quantité (en puissance et énergie).