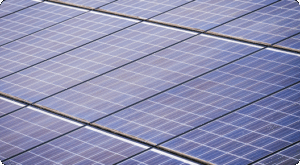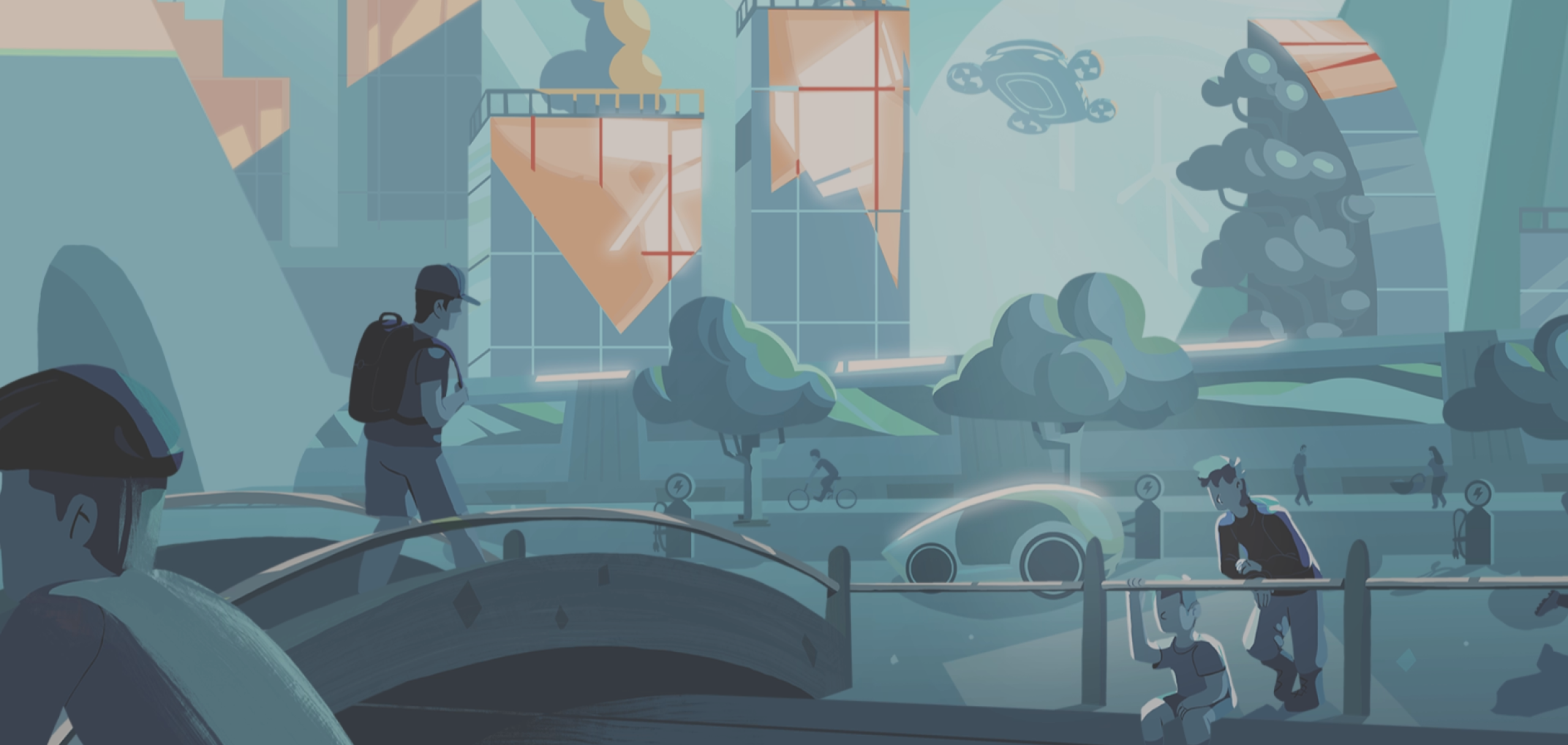Transition solaire : où en sommes-nous ?
Produire 45 TWh (térawattheures) d’énergie renouvelable (hors hydraulique) d’ici à 2050. Tel est l’objectif accepté en juin 2024 par le peuple suisse, à l’occasion de la votation sur la loi sur l’électricité. Et le contexte laisse peu de place au doute : la majeure partie – soit environ 40 TWh, selon les spécialistes – devra provenir du photovoltaïque. Aujourd’hui, la production solaire nationale atteint environ 8 TWh par an. Il faudra donc la multiplier par cinq en un quart de siècle. Un défi de taille, mais jugé réaliste par Yannick Sauter, coordinateur romand de l’association Swissolar. « À condition d’atteindre et de maintenir un rythme d’installations photovoltaïques équivalent à 2 GW par année », précise-t-il. Selon les chiffres de l’association, nous avons frôlé 1,8 GW en 2024.
Tenir le cap exige toutefois une mobilisation soutenue. Or les prévisions de Swissolar pour les deux prochaines années annoncent un recul des nouvelles installations solaires (1,51 GW pour 2025). Selon Yannick Sauter, plusieurs facteurs expliquent cette tendance. En ce qui concerne les grandes installations – souvent réalisées par des investisseurs ou via des modèles de contracting –, le flou politique et juridique des derniers mois, notamment autour de la loi sur l’électricité, a freiné les décisions. « Le cadre légal doit se stabiliser pour regagner la confiance de ces acteurs », affirme-t-il. « Chez les propriétaires de villas, le ralentissement s’explique plutôt par l’évolution des préoccupations de la population. » Et de citer le baromètre ex-Credit Suisse de ces préoccupations pour 2021-2022, dans lequel l’approvisionnement énergétique, le risque de black-out et les enjeux climatiques figuraient en tête. « En 2023-2024, ces thèmes ont reculé dans les priorités des Suisses, au profit du pouvoir d’achat et des coûts de la santé », résume-t-il.
« Le cadre légal doit se stabiliser pour regagner la confiance de ces acteurs »
Retour à la réalité des prix
Il faut dire aussi qu’après plusieurs années marquées par des prix de rachat de l’électricité photovoltaïque élevés, dopés par la crise énergétique, la Suisse revient progressivement à un niveau plus stable. « Et plus proche de la norme », affirme Yannick Sauter. Pour les petites installations, le prix de rachat minimal est désormais fixé à 6 centimes par kilowattheure, auxquels s’ajoutent les garanties d’origine, d’environ 2 centimes par kilowattheure. Soit un tarif total comparable à celui pratiqué entre 2016 et 2020 – et jugé cohérent par les professionnels de la branche. « En toile de fond, c’est tout un modèle économique qui se rééquilibre, et la logique s’oriente vers un marché plus juste, même si cela implique une baisse temporaire du nombre de nouvelles installations », résume Yannick Sauter.
« Concernant la technologie, les marges de progression des panneaux solaires sont aujourd’hui plutôt limitées », affirme Thomas Mudry, directeur de OIKEN Solutions. « Ils gagnent surtout en taille : à surface égale, les gains significatifs en productivité restent en effet plutôt modestes. » Aucun saut technologique majeur, directement utilisable pour les installations standardisées, ne semble par ailleurs se profiler à court terme, dans un marché largement dominé par l’Asie. Du côté des procédures, les choses se sont néanmoins améliorées. « Pour les projets sur le bâti, les autorisations sont désormais simples dans la grande majorité des cas », affirme Yannick Sauter. « Quelques blocages subsistent, notamment pour les installations en zones agricoles, mais globalement le cadre administratif s’assouplit. » L’enjeu est donc plutôt de savoir à quel endroit installer les panneaux afin de maximiser la production d’électricité.
Collectivités et grands propriétaires au cœur du potentiel solaire
Selon les chiffres de Swissolar, environ 95 % de la production photovoltaïque se fait aujourd’hui sur les toits. Cette part devrait être ramenée à 60 % dans les années à venir, à mesure que la part d’énergie produite en façade des bâtiments et sur les infrastructures va progresser. « La majorité des grandes toitures facilement exploitables ont été équipées », ajoute Thomas Mudry. Il précise que celles qui sont encore disponibles posent souvent des défis techniques, financiers ou organisationnels : bâtiments nécessitant une rénovation complète, copropriétés avec de multiples parties prenantes ou encore toitures moins favorables. Et si, grâce au photovoltaïque intégré au
bâtiment (PVIB), les considérations esthétiques ne sont plus un argument pour refuser d’équiper les bâtiments historiques ou classés, le surcoût de ces technologies peut cependant demeurer un frein à leur déploiement massif.
Pour Yannick Sauter, ce sont les bâtiments publics qui offrent une vraie opportunité à court terme pour le photovoltaïque : « Les communes, les cantons et la Confédération commencent réellement à évaluer leur patrimoine bâti, souvent bien exposé et techniquement accessible. » Autre levier important : les bâtiments détenus par les grands propriétaires immobiliers et les fonds de pension. « Ce segment est très en retard, mais dispose d’un énorme potentiel. C’est là que se joue une bonne part de la marge de progression du photovoltaïque sur les bâtiments », ajoute-t-il.
Un défi pour l’équilibre des réseaux électriques
Avec l’augmentation des installations solaires, les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) doivent quant à eux adapter leurs infrastructures à des fluctuations de production de plus en plus marquées. Les périodes de fort ensoleillement entraînent en effet des pics de production, tandis que la demande est alors plus faible. « Aujourd’hui déjà, sur certaines extrémités des réseaux, nous atteignons parfois des niveaux de charge importants », confirme Thomas Mudry. Faut-il pour autant investir massivement dans leur renforcement pour quelques heures critiques par an ? « Ces investissements sont couverts par le tarif d’acheminement », rappelle-t-il. « Or celui-ci est facturé uniquement sur l’électricité consommée, pas sur l’électricité produite, ce qui, de facto, fait peser une charge de plus en plus lourde sur les consommateurs qui ne possèdent pas d’installation solaire, en particulier les locataires. »
D’où la nécessité d’évaluer des alternatives aux renforcements classiques de réseaux. La loi sur l’électricité prévoit ainsi la possibilité pour les GRD de faire de l’écrêtage, c’est-à-dire de limiter la réinjection de la production de courant photovoltaïque de leurs clients, grâce à un pilotage des installations solaires. « Le cadre réglementaire permettra, sous certaines conditions, une rétribution des producteurs touchés par ces limitations », précise Thomas Mudry. Autre évolution majeure pour les GRD : le déploiement en cours de compteurs intelligents. « Les modalités de leur utilisation doivent aussi être encadrées, mais ces dispositifs permettront, entre autres, de mettre en place une tarification dynamique », ajoute-t-il. Concernant les tarifs de reprise de l’énergie solaire, la loi sur l’électricité prévoit un modèle dans lequel plus l’offre de courant photovoltaïque est importante, plus le prix de rachat est bas, ce qui doit inciter les propriétaires à autoconsommer ou à stocker leur production.
Du stockage, mais l’autoconsommation d’abord
Côté stockage d’énergie, la tendance chez les professionnels est de réaliser des installations solaires avec un système pouvant accepter des batteries. « Nous anticipons la possibilité d’ajouter chez nos clients une unité de stockage ou une borne de recharge pour véhicule électrique, mais sans les pousser à l’achat tant que le besoin réel n’est pas démontré », résume Thomas Mudry. Yannick Sauter confirme : « Aujourd’hui, certains propriétaires de villas se dotent d’emblée de batteries sans réelle gestion et optimisation de l’énergie. Or ces équipements, s’ils sont mal paramétrés, n’aident pas le réseau et n’apportent pas non plus nécessairement une réelle valeur ajoutée au producteur ».
Finalement, l’autoconsommation semble revenir au centre du jeu. « Avant même de penser à vendre ou à stocker son électricité, mieux vaut utiliser au maximum sur place ce que l’on produit », résume Yannick Sauter. Sur le terrain, il n’est toutefois pas toujours facile de convaincre les propriétaires d’optimiser leur consommation, surtout quand le gain économique n’est pas immédiat. « Jusqu’où peut-on aller pour expliquer que chaque petit geste a du sens, sans glisser du pragmatisme à l’idéologie ? » s’interroge Thomas Mudry.
Partager l’électricité avec ses voisins
Des modèles de partage de l’électricité solaire apparaissent ainsi comme des outils intéressants pour valoriser la production locale. Autorisés depuis 2018, les RCP (regroupements dans le cadre de la consommation propre) permettent à plusieurs habitants d’un bâtiment équipé de panneaux solaires de se regrouper pour maximiser la consommation d’électricité ainsi produite. Du point de vue du distributeur, le RCP est considéré comme un consommateur unique ; l’énergie échangée/vendue au sein du RCP n’est ainsi pas soumise aux frais d’acheminement du réseau. Depuis cette année, les RCP peuvent être étendus à plusieurs bâtiments voisins au sein de RCP dits virtuels, avec, là encore, un seul point de comptage (virtuel) vis-à-vis du distributeur.
« Jusqu’où peut-on aller pour expliquer que chaque petit geste a du sens, sans glisser du pragmatisme à l’idéologie? »
Dès 2026, des regroupements encore plus larges, jusqu’à l’échelle d’une commune, pourront être formés via des communautés électriques locales (CEL), avec des coûts d’acheminement de l’électricité calculés en fonction de la proximité de leurs membres. « Nous verrons à l’usage, mais partager son énergie avec un voisin immédiat semble a priori plus pertinent qu’un partage étendu à toute une commune, surtout si les économies sur les frais d’acheminement restent marginales », nuance Thomas Mudry. Pour Yannick Sauter, ces modèles de partage de l’électricité ne devraient pas révolutionner le paysage énergétique à court terme. « Mais ils joueront sans doute un rôle de plus en plus important pour convaincre et soutenir ceux qui souhaitent investir dans une installation photovoltaïque dans un contexte de prix plus serré », conclut-il.
Et le solaire thermique ?
Tandis que les panneaux photovoltaïques convertissent l’énergie du rayonnement solaire en électricité, les panneaux thermiques la convertissent en chaleur. « Cette technologie est très pertinente du point de vue énergétique et offre un excellent rendement », résume Thomas Mudry, directeur de OIKEN Solutions. « Aujourd’hui, il est toutefois plus rentable pour le propriétaire d’une villa ou d’un petit bâtiment de combiner une pompe à chaleur et des panneaux photovoltaïques pour produire de l’eau chaude sanitaire. »
C’est dans le domaine de l’industrie que l’exploitation de la chaleur du soleil offre le plus grand potentiel. Un potentiel « largement sous-exploité », selon l’association Swissolar, qui rappelle que près de 20% des besoins en chaleur sont attribuables aux processus industriels. La moitié environ de ces processus de production requièrent des températures inférieures à 250°C, compatibles avec une production de chaleur d’origine solaire.
Les chiffres du photovoltaïque en Suisse
Source : Swissolar, Baromètre du marché solaire suisse 2024
8GW
11%
28,3TWh
10e
10 000
3,3 milliards