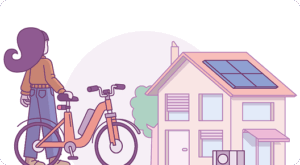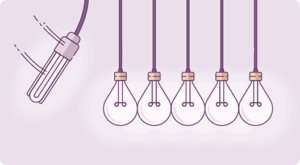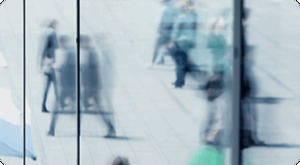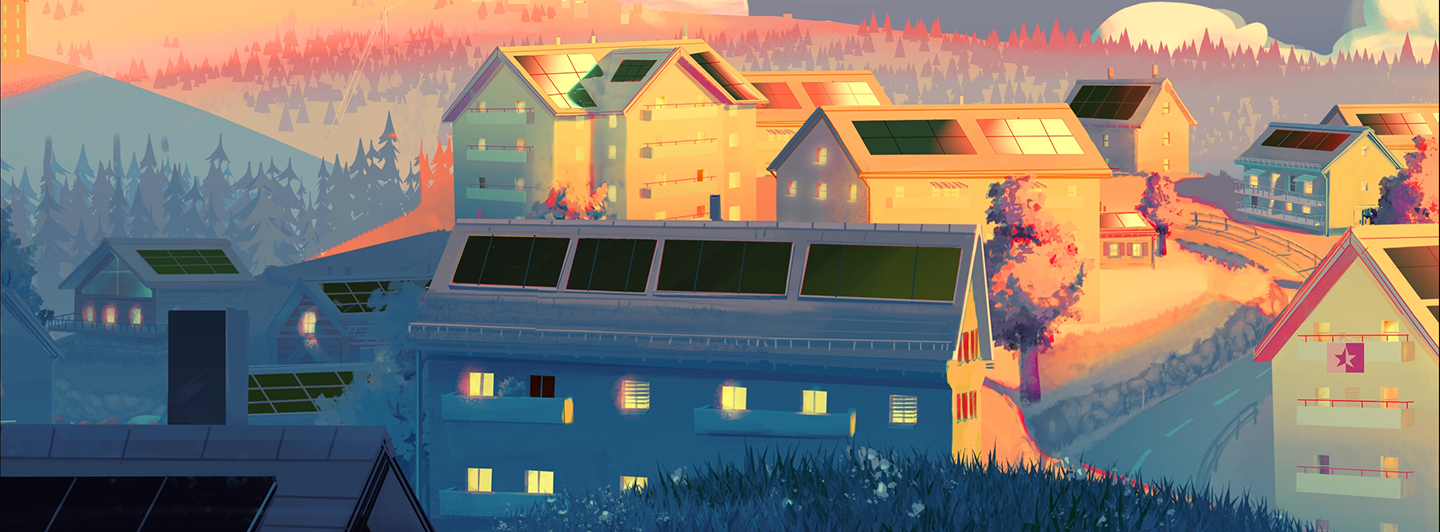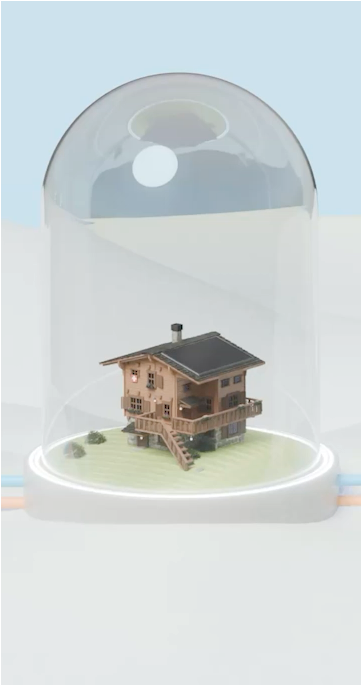La transition a besoin de tout le monde
On aimerait croire que la technologie va tout régler. Qu’il suffira d’inventer pour continuer comme avant, sans trop changer nos habitudes. L’idée est rassurante. Mais les solutions techniques pour mener à bien la transition énergétique existent déjà, ou presque. Ce qui fait défaut, c’est la modification de nos comportements.
Pourquoi continue-t-on à agir comme si de rien n’était, malgré le consensus scientifique sur l’origine humaine du changement climatique ? Pourquoi certains projets énergétiques se heurtent-ils au rejet, quand bien même ils sont perçus comme nécessaires ? Pourquoi ce décalage entre la prise de conscience et le passage à l’action ? Ce sont ces questions – parmi d’autres – que nous avons explorées, en croisant psychologie, politique et économie. Car, pour avancer, il ne suffit pas de savoir quoi faire. Encore faut-il comprendre pourquoi on ne le fait pas déjà…
L’inertie individuelle
« Les enjeux climatiques sont difficiles à appréhender », admet Lisa Moussaoui, psychologue spécialisée dans les comportements pro-environnementaux et fondatrice du bureau genevois Behaviour Change Expertise. La thématique est en effet complexe et globale, avec de multiples acteurs et de nombreuses incertitudes. Et puis les conséquences des actes individuels sur le climat sont rarement visibles à court terme. Par ailleurs, lorsque les informations sont perçues comme trop alarmantes, elles peuvent provoquer des réactions de défense. « Si on pense qu’on ne pourra pas faire face à une menace, on la minimise, on la nie ou on délègue la responsabilité du changement à la technologie ou aux autorités », précise la psychologue.
« Si on pense qu’on ne pourra pas faire face à une menace, on la minimise, on la nie ou on délègue la responsabilité du changement à la technologie ou aux autorités. »
Elle relève aussi la force des habitudes, mais surtout celle du confort. Il ne s’agit toutefois pas de culpabiliser les individus ; selon Lisa Moussaoui, il est surtout important de comprendre que le découragement est un frein majeur à l’action, donc au changement. « Quand on voit la consommation d’énergies fossiles de certains pays, les discours climatosceptiques d’acteurs politiques puissants ou la lenteur de certaines avancées, il est facile de penser que nos efforts sont inutiles », souligne-t-elle. Et c’est bien là le principe du dilemme social : individuellement, l’effort paraît vain ; collectivement, il est indispensable.
Du déclic au changement
Alors, comment lutter contre ce découragement ? « En observant les comportements positifs autour de soi, comme autant de bons exemples qui permettent de réaliser que l’on n’est pas seul à faire des efforts », répond Lisa Moussaoui. Car chaque geste compte. Rappelons, en effet, que si la Suisse est un petit pays, l’empreinte carbone par habitant y est élevée – 14 tonnes d’équivalent CO₂ par an, soit trois fois la moyenne mondiale. Le potentiel de changement individuel est donc important, et chacun d’entre nous peut réellement avoir un impact. « Les gens font des choses parce qu’ils y croient », ajoute la spécialiste. « Si on agit uniquement par obligation, il y a un risque de résistance ou de contournement de la règle. » Sans compter qu’il est vain d’attendre des individus des comportements plus écologiques si les dispositifs en place ne permettent pas de les adopter facilement. « Si l’offre de transport ou d’alimentation durable n’existe pas ou est inaccessible, on ne peut pas agir, même avec la meilleure volont », illustre Lisa Moussaoui.
« Les politiques publiques actuelles reposent beaucoup sur l’incitation douce et la bonne volonté », poursuit-elle. « Mais cela ne suffira pas. Il faut mobiliser tous les leviers : information, incitations, contrainte et adaptation structurelle. » Car de la prise de conscience aux actes, il n’y a, malheureusement, pas qu’un pas. Le passage à l’action repose en effet sur plusieurs étapes : se sentir concerné, savoir quoi faire, se sentir capable de le faire et croire que cela aura un impact. « Et ça peut bloquer à chacune de ces étapes, à cause de croyances limitantes ou de contraintes pratiques », explique la psychologue.
Incarner les messages, ajuster les subventions
« Tous les instruments politiques ont leurs avantages, mais également leurs limites », confirme Isabelle Stadelmann-Steffen, professeure de politiques comparées à l’Université de Berne. Elle plaide donc, elle aussi, pour un mix. « L’information seule est généralement peu efficace ; de plus, elle peine à atteindre les publics concernés », affirme-t-elle. Cette limite, Mehdi Farsi l’a également observée sur le terrain. Professeur d’économie à l’Université de Neuchâtel, il s’intéresse aux comportements liés à la consommation d’énergie. Il a récemment dirigé une expérience de suivi de consommation auprès de 300 ménages, via une application. « Nous avons constaté qu’il ne suffit pas de dire aux gens qu’ils consomment trop ; il faut leur expliquer concrètement comment réduire cette consommation », résume-t-il. « Et ces messages sont plus efficaces s’ils sont adaptés au public cible et s’ils sont transmis par un acteur de terrain, plutôt que par une autorité lointaine. » Quant aux incitations financières, même si elles permettent d’orienter les comportements sans les imposer, leur impact est politiquement sensible. « Elles profitent souvent davantage aux plus aisés », affirme Isabelle Stadelmann-Steffen. Un point de vue partagé par Mehdi Farsi, qui déplore que les aides financières soient généralement mal calibrées : « Aujourd’hui, pour en bénéficier, il est souvent nécessaire de combiner des mesures d’efficacité énergétique avec une installation de systèmes de production d’énergie renouvelable. Or certains propriétaires peuvent se permettre l’un, mais pas l’autre. »
Pas dans mon jardin !
Si la transition énergétique ne peut être menée à bien sans une part de responsabilité individuelle, elle relève plus largement d’une approche systémique. « Les changements dépendent des politiques publiques et des infrastructures disponibles, mais également du soutien collectif aux projets en faveur de la transition », explique Isabelle Stadelmann-Steffen. Or on constate un écart important entre la perception positive de certaines technologies, comme l’éolien ou le solaire, et leur acceptation sur le terrain. C’est la fameuse attitude « NIMBY » (Not In My Backyard, en français « pas dans mon jardin »). Mais ce n’est pas la seule explication. « On doit aussi entendre les objections à des projets précis, comme un mauvais emplacement, une mauvaise qualité du dossier ou encore un déséquilibre entre les bénéfices globaux et les impacts locaux », ajoute la politologue.
Ce contexte est particulièrement sensible en Suisse, où la culture de la participation locale est très importante. « C’est une force, car elle permet d’améliorer les projets par la prise en compte des avis des populations directement concernées ; cela rend toutefois leur mise en oeuvre plus difficile », résume Isabelle Stadelmann-Steffen. C’est d’ailleurs pour atténuer ce mécanisme que les habitants du canton de Lucerne ont récemment accepté de confier à l’autorité cantonale la compétence pour décider des projets éoliens. « Ce qui signifie que les communes ne peuvent plus s’y opposer directement », explique-t-elle.
Au-delà des clivages politiques
Il faut dire aussi que les procédures de consultation offrent autant d’opportunités de récupération politique à ceux qui s’opposent, par principe, à de tels projets. Isabelle Stadelmann-Steffen relève en outre que le phénomène de polarisation peut ralentir, voire bloquer, certaines dynamiques : « Nos recherches ont montré que des individus accueillent positivement une taxe écologique redistribuée de façon équitable, dès lors qu’ils sont informés de ses avantages économiques. Mais lorsque l’on précise que cette mesure est soutenue par certains partis politiques et rejetée par d’autres, les arguments partisans prennent le dessus sur le bénéfice matériel. »
« On doit intégrer les dimensions comportementale et sociale à chaque projet technique. »
Quels sont donc les messages qui rassemblent ? « La sobriété est une idée généralement maniée avec précaution, car elle est associée à la décroissance, or ce terme est un véritable repoussoir pour une grande partie de la population », souligne la politologue. « La décroissance est d’ailleurs instrumentalisée par les opposants à la transition pour susciter la peur et le rejet. » Elle indique que le récit de l’indépendance énergétique, en lien avec la sécurité d’approvisionnement, est, au contraire, celui qui fédère le plus. « On l’a vu au début de la guerre en Ukraine », rappelle-t-elle. « Et le Conseil fédéral a su utiliser ce levier dans la campagne pour la Loi sur l’électricité, en mettant l’accent non pas sur la transition, mais sur l’indépendance énergétique de la Suisse. »
Croiser les regards
Finalement, comment mieux prendre en compte le facteur humain dans la mise en oeuvre de la transition énergétique ? « En intégrant les dimensions comportementale et sociale à chaque projet technique », répond Isabelle Stadelmann-Steffen. Elle apprécie d’ailleurs d’être de plus en plus sollicitée pour participer à des projets de recherche collaboratifs entre sciences sociales et sciences dites « dures ». « Aujourd’hui, même les ingénieurs et les techniciens reconnaissent la nécessité de travailler aussi sur les questions d’acceptabilité et de mobilisation », dit-elle.
Lisa Moussaoui collabore quant à elle avec les autorités genevoises sur divers projets en lien avec le développement durable – tri des déchets ou mobilité, par exemple. « On commence par mener des enquêtes pour comprendre les freins, puis on propose des actions adaptées », explique-t -elle. « Ce travail est déjà intégré à certains niveaux politiques ; il y a toutefois encore un gros potentiel, surtout si les décideurs prennent conscience de la richesse de ces approches comportementales et sociales. »
C’est peut-être à cette condition qu’un changement de société pourra réellement être amorcé. Pas uniquement dans les textes, mais aussi dans nos actes.