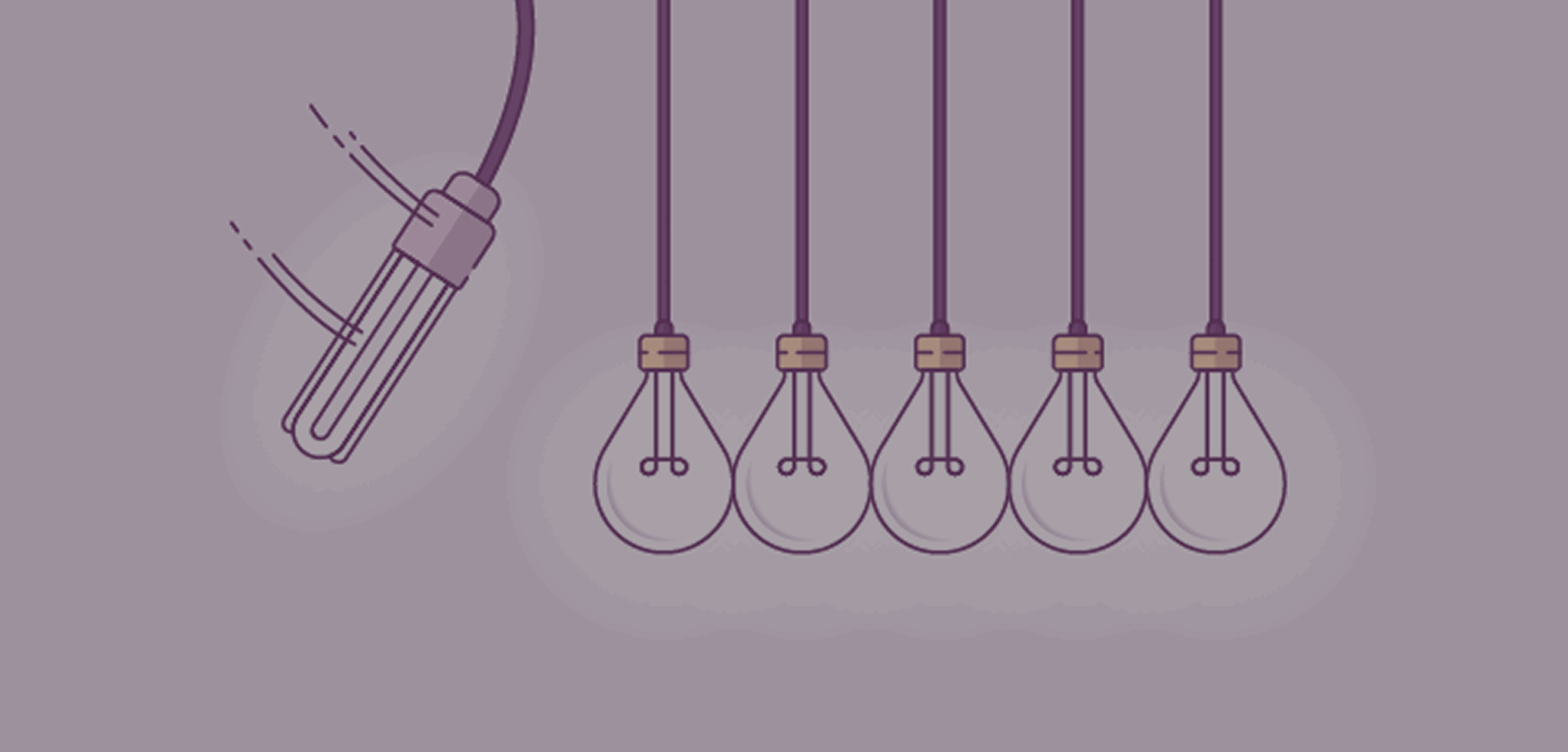
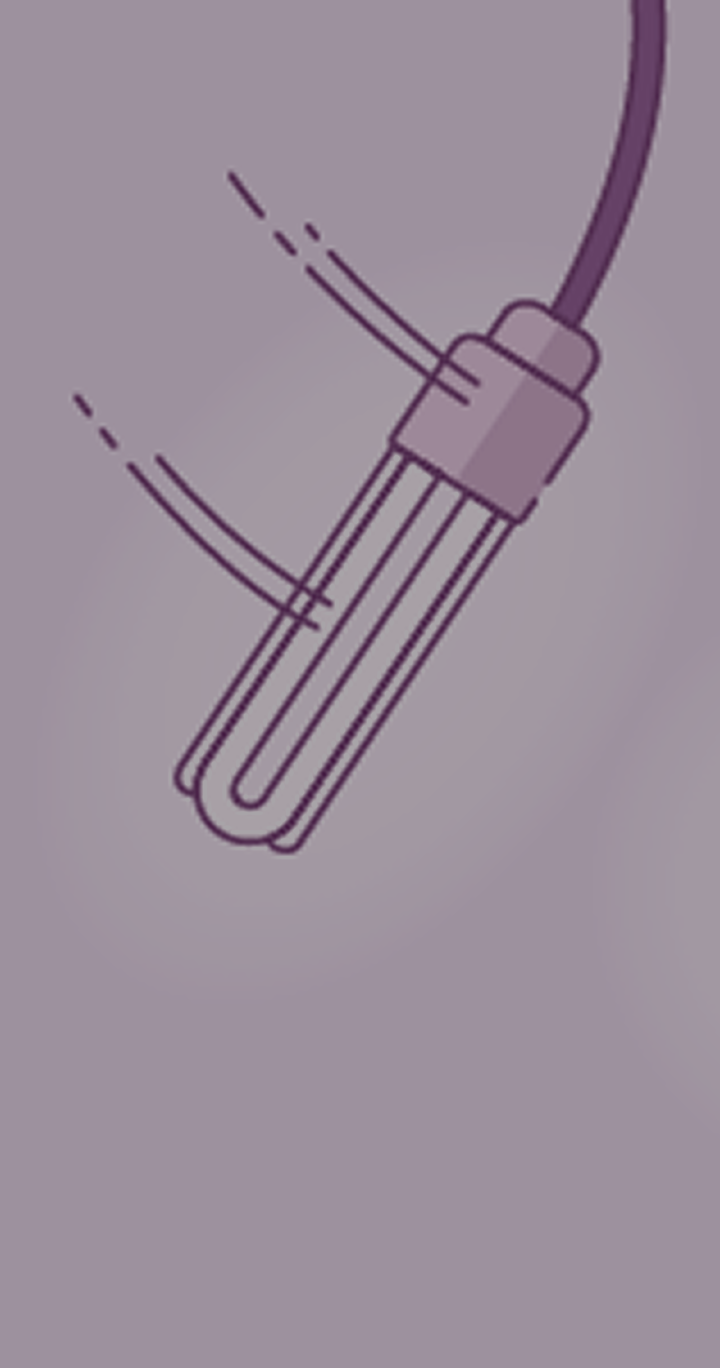
Effet rebond Questions à Mehdi Farsi

Mehdi Farsi
Professeur à l’Institut de recherches économiques de l’Université de Neuchâtel
Qu’est-ce que l’effet rebond ?
C’est la décorrélation entre un gain réel d’efficacité énergétique et la réduction attendue de la consommation. Autrement dit, on consomme moins d’énergie, mais pas autant qu’on le pourrait. Et la différence n’est pas liée à la technologie, mais à des comportements humains et à des mécanismes économiques.
Pouvez-vous donner quelques exemples ?
L’effet rebond se retrouve dans plusieurs domaines. Prenons celui de l’habitat : améliorer l’isolation diminue les coûts de chauffage, ce qui peut conduire à vouloir augmenter la température intérieure, à ouvrir plus souvent les fenêtres ou à chauffer des pièces qui ne l’étaient pas auparavant. Idem pour la mobilité : une voiture plus efficace fait baisser le coût par kilomètre, ce qui incite à rouler plus, surtout avec une voiture neuve, souvent plus confortable. Plusieurs études menées en Europe ont ainsi montré une perte jusqu’à 70 % du bénéfice d’efficacité à cause de l’effet rebond dans le domaine de la mobilité. Cet effet est toutefois très dépendant du contexte. Aux États-Unis, il est souvent plus faible, car l’usage est déjà très élevé, tandis qu’en Europe, avec plus d’alternatives à la voiture, comme les transports publics, le rebond peut être plus important. L’effet rebond varie aussi selon le contexte socio-économique ; il est plus marqué chez les ménages à faibles revenus, les hauts revenus consommant déjà suffisamment.
« Si on sous-estime l’effet rebond, on surestime les gains d’efficacité, donc les économies d’énergie réelles. »
Selon vous, l’effet rebond est-il suffisamment pris en compte dans les politiques énergétiques ?
Non. On est souvent trop optimistes sur l’impact des gains d’efficacité, surtout que la plupart des estimations sont faites à court terme. Or, à long terme, l’effet rebond peut être encore plus élevé, car les comportements évoluent : on gagne en confort, on utilise l’objet plus souvent ou différemment, on achète une télé plus grande, une voiture plus grosse, etc. Et si on sous-estime l’effet rebond, on surestime les gains d’efficacité, donc les économies d’énergie réelles.
Quelles stratégies permettent de limiter l’effet rebond ?
Il ne suffit pas de développer des technologies plus efficaces et d’encourager leur adoption ; il faut aussi accompagner ces innovations avec des messages adaptés. Par exemple, lorsqu’on remplace une installation de chauffage, on peut expliquer à son propriétaire que le nouveau système est plus performant, certes, mais qu’il reste essentiel de garder certains gestes comme fermer les fenêtres, dans la mesure du possible, et contrôler la température. Il faut aussi insister sur le fait que l’on peut réduire sa consommation sans renoncer au confort. Et puis il existe des outils connectés qui facilitent les bons réglages. Je rappellerais enfin que l’effet rebond concerne surtout l’efficacité. Avec la sobriété et les renouvelables, il est bien moindre, voire inexistant. C’est en combinant ces trois leviers – sobriété, efficacité et énergies renouvelables – que l’on pourra avancer de façon cohérente.


