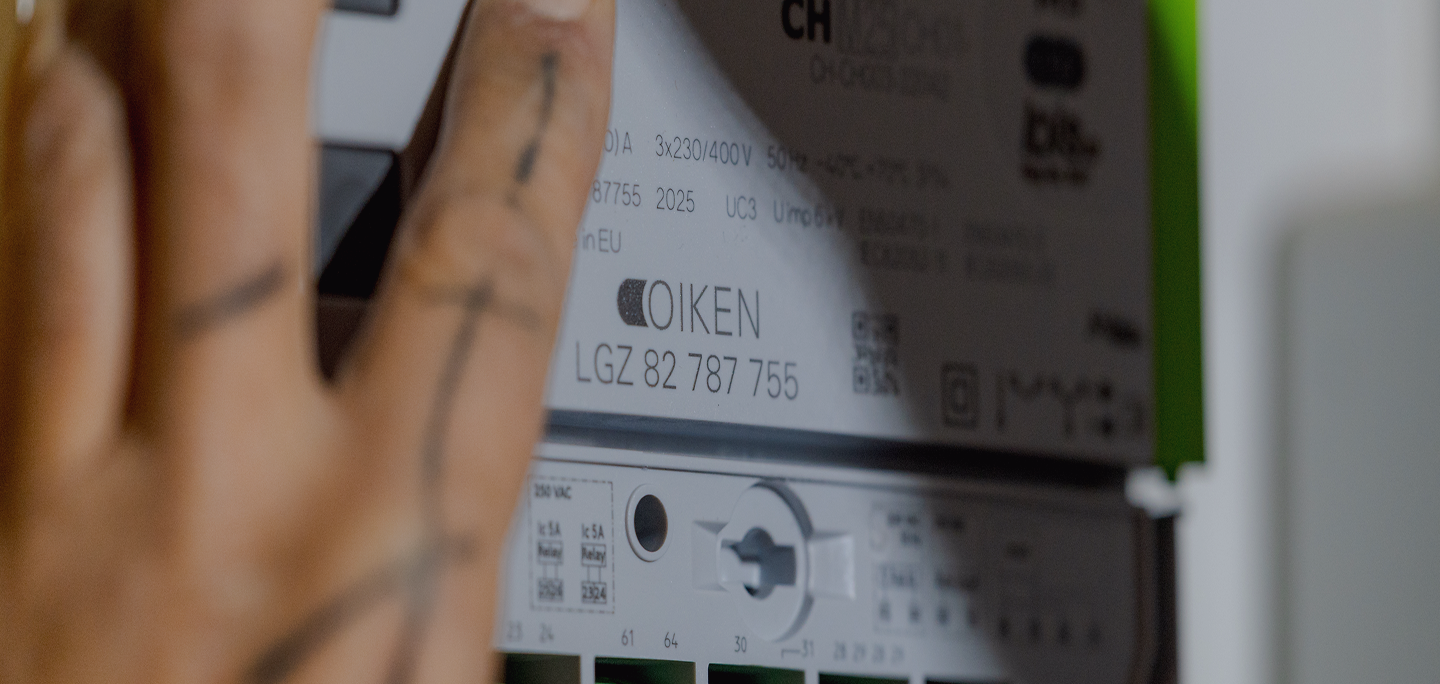La sobriété d’abord ?
Sobriété. Le terme effraie parfois. Pour certains, il évoque immédiatement la privation, voire un retour à la bougie. Mais pas pour negaWatt Suisse. « La sobriété ne signifie pas vivre dans des grottes », sourit David Moreau, ingénieur en sciences et ingénierie de l’environnement et codirecteur de l’association. « C’est une démarche volontaire et organisée, qui vise à améliorer notre qualité de vie tout en respectant les limites planétaires. » La sobriété engage ainsi autant les individus que les entreprises et les collectivités publiques. Pour autant, il ne suffit pas de baisser le chauffage pour que cela fonctionne ! « Il faut des politiques publiques, des infrastructures adaptées et un cadre clair pour que les comportements sobres deviennent des évidences plutôt que des sacrifices », résume-t-il.
Un potentiel négligé
Né en France au début des années 2000, le mouvement negaWatt a, depuis, fait école. En Suisse, l’association a vu le jour en 2018. En 2020, elle a publié un scénario énergétique pour le pays, selon lequel une réduction de 20 à 35 % de la consommation d’énergie est possible, « en agissant sur les organisations et modes de vie », souligne David Moreau. Pour l’heure, ce potentiel ne semble toutefois que peu pris en compte. « Alors qu’il existe de nombreuses études sur les énergies renouvelables ou l’efficacité énergétique, notamment du côté de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), on ne trouve pratiquement rien qui porte spécifiquement sur la sobriété », regrette-t-il. Oubli, désintérêt, tabou ? « La sobriété dérange, car elle questionne notre rapport à la consommation et au confort », poursuit l’ingénieur. La sobriété évoque aussi la décroissance, aux antipodes de notre modèle économique actuel.
De l’importance des choix politiques
David Moreau assume toutefois ce dernier point et affirme que le contexte climatique implique bel et bien de questionner notre modèle économique. « Nous pouvons trouver une façon de consommer mieux mais moins », soutient-il. Et de citer les nouvelles approches comme les coopératives de logement, les bibliothèques d’objets ou l’économie du partage. Le codirecteur de negaWatt Suisse insiste aussi sur l’importance des choix politiques qui vont permettre à la population d’adopter des modes de vie plus sobres. « En matière de mobilité, on ne pourra pas faire évoluer les comportements si les alternatives ne sont pas là », explique-t-il. « Si vous n’avez pas d’arrêt de bus près de chez vous, vous ne prendrez jamais le bus. » David Moreau se dit également prudent avec les appels à la responsabilité individuelle. « Le secteur du bâtiment, à lui seul, représente environ 50 % de la consommation énergétique suisse », rappelle-t-il. « Mais si je suis locataire dans une passoire thermique chauffée au mazout, je ne peux pas faire grand-chose dans ce domaine. »
« Il faut des politiques publiques, des infrastructures adaptées et un cadre clair pour que les comportements sobres deviennent des évidences plutôt que des sacrifices. »
Favoriser le débat public
Alors, qui le peut ? « Il faut intégrer clairement la sobriété dans les politiques publiques », répond le codirecteur de negaWatt Suisse. Et ça commence à bouger : ici ou là, elle s’invite en effet dans les plans directeurs, les lois cantonales ou les programmes d’action. « Pour l’instant, ce sont surtout des intentions », explique-t-il. Afin d’encourager l’action, l’association conseille les collectivités et construit un réseau national pour faire monter le sujet dans le débat public. « C’est un travail de fond que nous menons en collaboration avec le WWF, la Fondation suisse de l’énergie, Greenpeace et les universités de Lausanne, Berne et Zurich », explique David Moreau. Il précise que la démarche se veut transpartisane : « Au niveau national, ce sont souvent des partis de gauche qui soutiennent la sobriété. Mais sur le terrain, les clivages s’effacent ; un élu UDC peut tout à fait défendre les vélos-cargos ou les transports publics si ça répond à un besoin local concret. »
Par quoi commencer ?
Faire évoluer les politiques publiques n’est toutefois pas le seul levier à actionner en matière de sobriété. Le changement peut aussi venir d’en bas, porté par les comportements individuels. Alors, par quoi commencer ? « Difficile de donner une recette », répond David Moreau, qui glisse toutefois quelques pistes. D’abord, prendre le temps d’observer sa propre consommation. « Mais ne nous flagellons pas avec les outils comme les calculateurs d’empreinte carbone », nuance-t-il. « Bien qu’utiles, ils sont parfois culpabilisants, car tout ne relève pas de notre responsabilité individuelle. » Ensuite, et si c’est possible, on peut baisser un peu la température dans son logement en hiver. « Et puis on peut voter pour des projets ou des personnes qui soutiennent la sobriété, voire s’engager soi-même dans des initiatives locales en ce sens. »
Mais la clé vers la sobriété réside peut-être aussi ailleurs, dans les imaginaires collectifs. « On est enfermés dans des modèles où réussir, c’est avoir une grande maison et une grosse voiture », résume le codirecteur de negaWatt Suisse. « Or une bonne qualité de vie peut aussi passer par le temps libre, les relations sociales et le partage… »