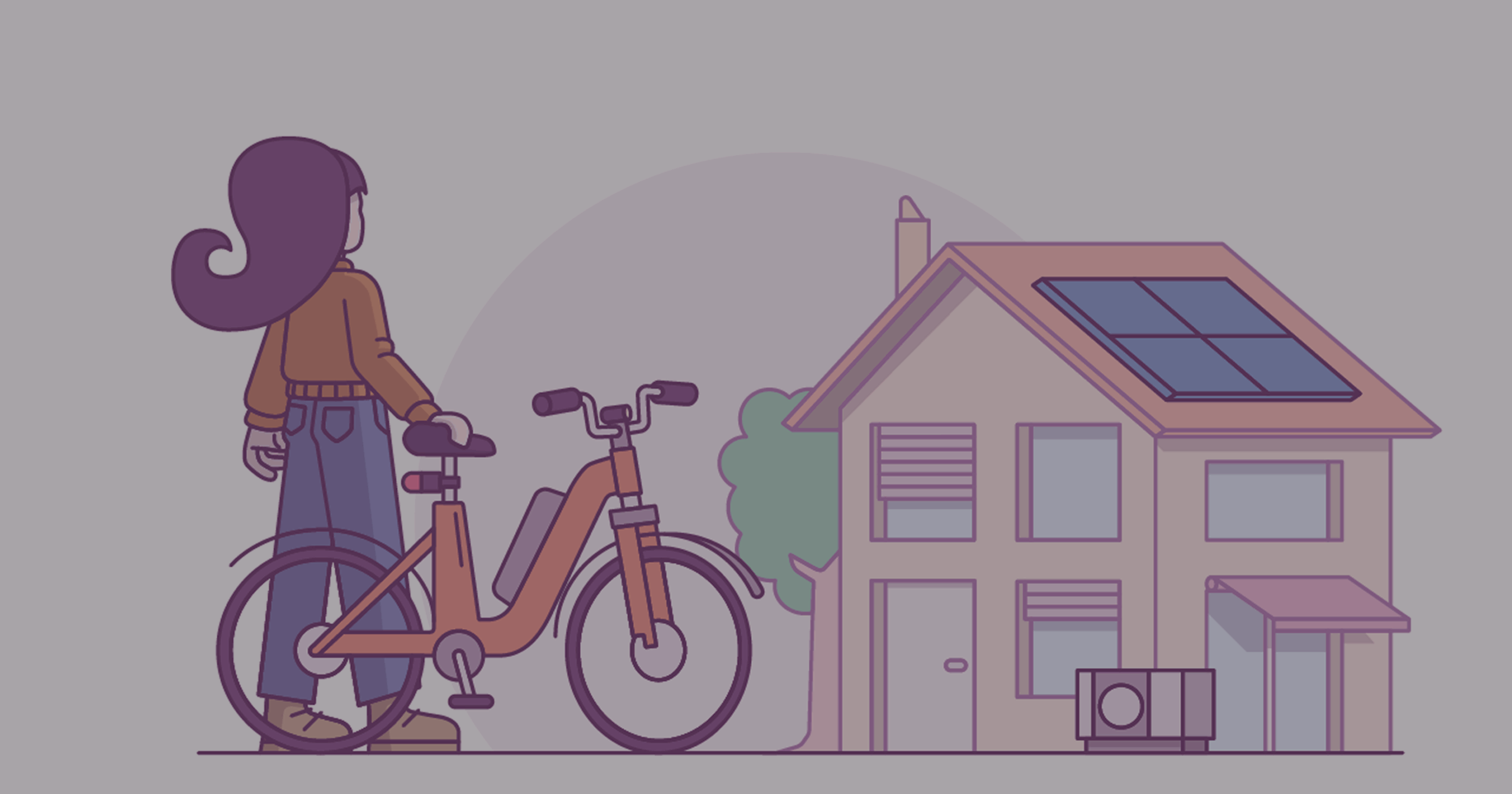Qui sont les climatosceptiques

Pascal Wagner-Egger
Chercheur en psychologie sociale à l’Université de Fribourg
Quand on parle de climatoscepticisme ou de déni climatique, de quoi s’agit-il vraiment ?
C’est une réalité à plusieurs visages. Certaines personnes expriment de simples doutes, parce qu’elles se disent que le sujet est encore débattu. Mais dans le cas du climat, il n’y a pas de controverse scientifique ! La quasi-totalité des climatologues sont en effet d’accord pour dire que le changement est bien lié aux activités humaines. D’autres rejettent purement et simplement ce consensus, ce qui peut traduire un manque de connaissances, ou une motivation à ne chercher que l’information qui conforte leurs désirs ou leur point de vue idéologique. Et puis il y a celles qui vont plus loin et en viennent à soupçonner un véritable complot.
Qu’est-ce qui nous empêche d’adhérer pleinement au consensus scientifique sur l’origine humaine du changement climatique ?
Il y a plusieurs raisons. D’abord, le changement ne se perçoit pas directement au quotidien. Et puis si un été est plus frais ou si la neige tombe de façon précoce, cela brouille la perception intuitive ou naïve que l’on a du climat. Mais c’est une façon de raisonner biaisée, parce qu’on privilégie des cas particuliers frappants au lieu de regarder les statistiques sur le long terme. Ensuite, il y a une dimension de confort psychologique. Admettre la réalité du changement, c’est accepter que nous devrions modifier nos habitudes. On préfère donc penser que le problème n’est pas si grave et ne nous concerne pas directement.
« Nous avons tous des biais cognitifs : on préfère les anecdotes aux statistiques, on cherche ce qui confirme nos idées ou on fait des liens de causalité trop rapides. »
Comment ce déni peut-il glisser vers le complotisme ?
Quand la minimisation ou le doute entrent en contradiction avec les efforts politiques manifestes pour contrer le réchauffement climatique, certains vont chercher plus loin. On prétend alors que les gouvernements exagèrent pour imposer des restrictions, que les mesures climatiques sont un prétexte pour contrôler la population, voire en limiter le nombre. On n’est plus seulement dans l’erreur de perception, mais dans la croyance qu’il y a un plan caché, organisé par une petite élite. Les récits de complot offrent une explication simple : « on nous ment », « on veut nous manipuler ». Il est parfois aussi plus confortable de croire que le problème n’existe pas ou qu’il est exagéré, plutôt que d’accepter que nous sommes face à un phénomène mondial aux conséquences lourdes.
Pourquoi certaines personnes y adhèrent-elles plus facilement ?
Plusieurs ressorts s’additionnent. Nous avons tous des biais cognitifs ; on préfère ainsi les anecdotes aux statistiques, on cherche ce qui confirme nos idées ou on fait des liens de causalité trop rapides. Mais certains profils psychologiques y sont plus sensibles, parce qu’ils se méfient de tout et pensent que les autres agissent souvent de manière malveillante. D’autres veulent avoir l’impression de comprendre ce que les « moutons » ignorent, ce qui les valorise. Le contexte social et politique joue aussi un rôle. Quand on se sent en bas de l’échelle par rapport aux décisions qui viennent « d’en haut », le discours complotiste est une revanche symbolique contre des élites jugées lointaines. Les extrêmes politiques utilisent d’ailleurs ce ressort. Enfin, les réseaux sociaux amplifient ce genre de récits en permettant de diffuser massivement de fausses informations, avec des algorithmes qui peuvent entretenir le biais cognitif de confirmation.

Manifestation de climatosceptiques en Australie
Retrouve-t-on les mêmes mécanismes que pour d’autres complots, par exemple autour du Covid ?
Oui. On part de données erratiques, c’est-à-dire des choses en apparence bizarres, et on les interprète comme des preuves. Pour le climat, c’est un hiver froid interprété comme une réfutation du réchauffement. Pendant le Covid, c’était la succession de chiffres contradictoires et de mesures parfois incohérentes qui amenaient certains à penser qu’on leur cachait des choses. Dans les deux cas, les « anomalies » sont utilisées pour construire une histoire qui paraît cohérente, mais qui repose sur une interprétation complètement exagérée, et surtout sans preuves.
Comment peut-on renforcer l’esprit critique face au déni climatique ?
Avec les jeunes, ce qui marche bien, c’est d’expliquer comment fonctionnent nos biais cognitifs et comment se construit la science. On ne leur dit pas « voilà ce qu’il faut penser », mais « voilà comment notre cerveau peut se tromper » et « voilà comment on vérifie une hypothèse scientifique ». Cela leur donne des outils pour réfléchir par eux-mêmes. Avec des proches déjà très convaincus, la confrontation directe est rarement efficace. Une bonne approche est ce qu’on appelle l’entretien épistémique : « comment es-tu arrivé à cette conclusion ? ». On ne juge ainsi pas la croyance, mais on questionne la manière de raisonner. Cela permet parfois à la personne de réaliser que sa méthode peut la conduire à accepter des affirmations contradictoires, et donc à douter de ses propres conclusions.
« Ce qui marche bien avec les jeunes, c’est d’expliquer comment fonctionnent nos biais cognitifs et comment se construit la science. »
Quid du côté des politiques publiques ?
La communication est déterminante. Les injonctions trop dures suscitent de la résistance, comme on l’a vu avec le Covid ; certaines personnes refusaient le vaccin uniquement parce qu’il était obligatoire. Pour le climat, il vaut mieux encourager que contraindre, avec des incitations positives. Cela peut passer par des aides financières, mais aussi par des comparaisons sociales, comme le fait de montrer à chacun où se situe sa consommation d’énergie par rapport à une moyenne. C’est ce qu’on appelle un « nudge », une incitation douce. Ce n’est pas parfait, mais c’est plus acceptable psychologiquement que la contrainte.
Finalement, qu’est-ce qui pèse le plus dans le déni climatique, nos biais personnels ou son instrumentalisation politique ?
Les deux s’entremêlent. Il y a des ressorts universels – nos biais cognitifs, le confort de nos habitudes – qui expliquent pourquoi chacun peut être tenté de minimiser. Mais il y a aussi une récupération politique, qui utilise ces discours pour attaquer le système en place. Et puis il existe une forme de déni ordinaire, beaucoup plus répandue, qui ne nie pas frontalement l’origine humaine du changement climatique mais qui minimise, détourne le regard et repousse à plus tard. C’est aussi problématique, car cela retarde également l’action collective.